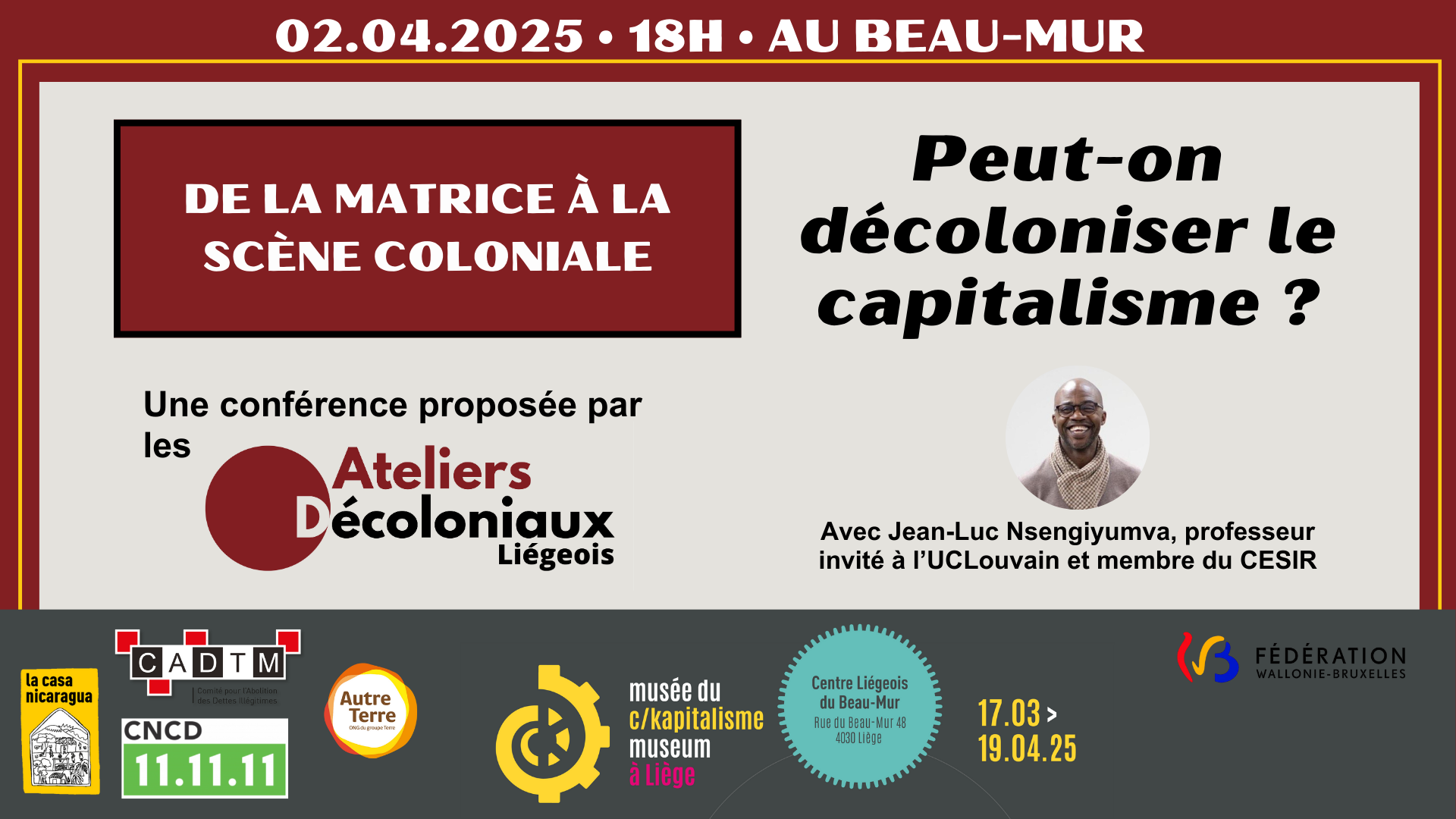En septembre 2024, nous avons réalisé un atelier pour réfléchir à l’impact de la colonisation sur notre perception de l’esthétique. L’objectif était de comprendre comment nos sens, notre perception de ce qui est beau ou de bon goût, sont encore influencés par l’histoire coloniale.
Pour ce faire, nous sommes d’abord revenu.e.s sur l’idée d’esthétique décoloniale, ou decolonial aesthesis en anglais, développée par le collectif modernité-colonialité-décolonialité (MCD), un groupe d’intellectuel.le.s majoritairement Sud Américain.e.s. Le MCD considère que la notion d’esthétique, qui définit ce qui est beau et de bon goût, a été introduite en Occident au XVIIIe siècle et a été imposée au reste du monde dans le cadre colonial. Le terme “esthésie décoloniale” renvoie aux pratiques qui bousculent ces normes esthétiques dominantes, que cela soit dans des projets artistiques, militants, ou à travers des pratiques de la vie quotidienne.
Après avoir abordé ce concept, nous avons discuté et réfléchi sur base d’un texte dans lequel Michelle K., une étudiante originaire de Singapour, s’écrit une lettre à elle-même plus jeune, qui s’apprête à partir étudier au Royaume-Uni. En effet, en partant étudier à Cambridge, Michelle a été confrontée à de nouvelles normes esthétiques dans divers domaines de sa vie : non seulement les normes artistiques, mais également des normes moins évidentes, plus “subtiles”, telles que la manière de se coiffer, de se tenir ou de parler.

A partir de ce texte, nous avons pu établir des parallèles avec nos propres expériences et réfléchir aux différentes formes que peuvent prendre les normes esthétiques dans nos vies, que cela soit les normes relatives au corps, ou aux productions artistiques et littéraires présentées comme “classiques”. Enfin, nous avons réfléchi aux manières de résister, de décoloniser notre perception et l’esthétique. Il peut s’agir par exemple de s’intéresser à d’autres références artistiques et littéraires, pour sortir du cadre de référence dominant et redécouvrir des formes d’art invisibilisées ou marginalisées par l’histoire coloniale.