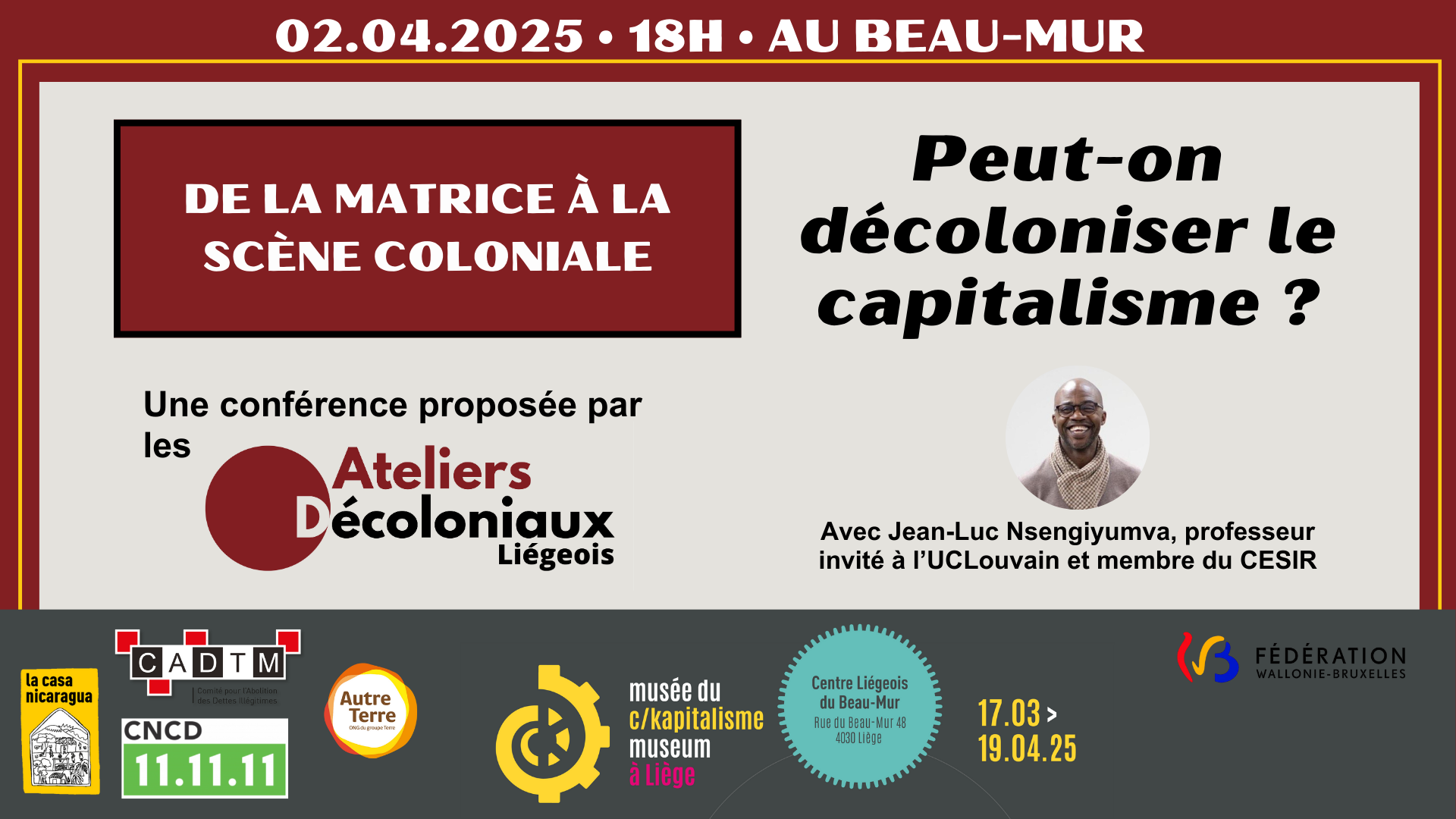Quelles luttes antiracistes et décoloniales à Liège ?
Quelques éléments d’histoire des luttes antiracistes et décoloniales à Liège nous ont été contés par Joseph Anganda. Comme plusieurs des intervenant·e·s l’ont souligné, il est important de connaitre l’histoire certes du racisme, mais aussi des luttes, pour comprendre les enjeux actuels.
NB : le lexique des luttes, le contexte, les enjeux et besoins ne sont pas les mêmes qu’aujourd’hui bien sûr. Nous ne parlions pas encore de « luttes antiracistes et décoloniales » en tant que telles dans les années 80-90.
A Liège, Ambroise Kalabela a d’abord fondé des initiatives contre le racisme avec le CLAN – Centre Liégeois des Artistes Noirs et le LIEN – la Ligue des Etudiants Noirs. Joseph Anganda, qui nous conte cette histoire, a rejoint ces associations au début des années 90. Au début, il s’agissait principalement d’étudiant·e·s noir·e·s qui s’organisaient contre le racisme : cela est notamment dû à la réalité migratoire post-coloniale belge. Un des enjeux est rapidement devenu d’élargir ce public-cible, afin que les luttes perdurent dans le temps. Les activistes antiracistes, décoloniaux et panafricains se sont alors tournés vers les nouvelles générations, les enfants et les jeunes.
Dans ces mêmes années, en parallèle, il existait également des groupes de soutien pour la régularisation des sans-papiers ainsi que des associations dites « de migrants ». Dans les années 90, le Mouvement des Nouveaux Migrants a été fondé par et pour les personnes issues de l’immigration post-coloniale. Ce mouvement est dès ses débuts soutenu par le monde associatif liégeois, déjà actif sur les questions relatives à la migration. Ensemble, ces associations et les citoyen·ne·s engagé·e·s vont lancer des occupations d’églises pour les sans-papiers, dont la première a pris place à l’église Saint-François de Sales dans le Laveu. Ces luttes, bien que non directement dirigées contre le racisme, les discriminations et la colonisation sont pourtant une conséquence de la colonisation de la Belgique au Congo, Rwanda et Burundi -et des immigrations post-coloniales qui y sont liées- ainsi que d’un système raciste et imprégné de colonialité qui détermine le (non)-accueil et le traitement des personnes migrantes.
Ce témoignage nous montre que les luttes antiracistes et contre la colonisation et la colonialité sont présentes depuis longtemps, et ce, dès l’arrivée en Belgique de personnes issues de l’immigration. Les personnes vivant le racisme et les discriminations ne sont pas restées les bras croisés et se sont organisées politiquement. Les soutiens et collaborations ont également été d’une grande importance pour ces luttes. Si le racisme et les discriminations à leur égard sont une réalité dès leur arrivée en Belgique et a perduré pour les descendant·e·s de l’immigration, les luttes contre le racisme et les discriminations sont également présentes dès ces premiers instants de l’immigration. Ces luttes passées ont ouvert la voie (et la voix) aux luttes présentes. Elles nous montrent aussi qu’un grand travail reste à faire, malgré quelques petites victoires. C’est contre des systèmes d’oppression puissants, historiquement bien logés en Belgique et globalement, se renforçant les uns et les autres, contre lesquels les militant·e·s doivent se battre pour plus de justice sociale. Mais ces luttes politiques subsistent, se transmettent, s’enrichissent, s’adaptent, depuis des décennies, et il semble important de les continuer.